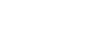L’introduction de la luzerne pour améliorer l’autonomie protéique d’un élevage doit se penser globalement, pour s’intégrer harmonieusement aussi bien au niveau agronomique que zootechnique. Denis Chapuis, conseiller expérimentation lait et fourrages à la CA71 fait le point sur cette culture.
Denis Chapuis a collaboré à la conception et à la réalisation des fiches « Profilait », dans le cadre de ce grand projet régional lancé en 2021, en partenariat avec les principales organisations professionnelles agricoles. Il tire des expérimentations conduites à la ferme de l’EPL laitière de Fontaines plusieurs enseignements concrets au sujet de la luzerne. « L’expérimentation conduite lors des hivers 2022/2023 et 2023/2024 sur l’alimentation des vaches laitières visait à maximiser l’autonomie protéique des vaches laitières avec de l’ensilage de luzerne et de l’herbe de qualité. Les résultats ont montré que le remplacement du maïs ensilage par du maïs épis et de la luzerne/herbe a eu un effet positif sur les performances laitières. », résume-t-il.
Rotation et ration
Mais attention, la luzerne n’est pas une culture capable de rendre autonome une exploitation d’un coup de baguette magique. « Avant tout, il faut se poser la question de sa destination et des objectifs. Cette culture a de nombreux atouts, agronomiques et zootechniques, mais il faut la penser dans le système, pour qu’elle s’intègre harmonieusement. En Bourgogne Franche-Comté, dans les exploitations de polyculture-élevage, que ce soit en viande ou en lait, la luzerne peut être un levier très efficace, pour peu que sa culture soit possible, et que la conduite soit adaptée aux objectifs. Elle améliore la structure des sols, brise le cycle des maladies et des parasites dans les rotations courtes, constitue un bon précédent avec ses capacités de fixation de l’azote atmosphérique, et améliore l’autonomie protéique. »
Premier écueil, celui du choix variétal : nord ou sud ? « Les variétés méridionales plus productives car plus précoces au moment du redémarrage, sont aussi plus sensibles aux gels tardifs, qui peuvent même les faire disparaître. Nous en sommes venus à les utiliser en mélange, avec des variétés plus septentrionales, pour une meilleure résilience face aux aléas climatiques. L’indice de précocité limite, en Bourgogne Franche-Comté, est 5,5 – 6 pas plus. »
Autre défi, la conduite. « Le mode d’exploitation de la luzerne est déterminant pour la longévité de cette culture, et, finalement, sa rentabilité dans le système. Pour qu’elle donne toute la mesure de sa plus-value agronomique, il faut éviter la surexploitation, notamment avec des fauches trop rases, en mauvaises conditions de portance, ou trop fréquentes. C’est une plante sensible aux tassements, dont il faut préserver les réserves pour qu’elle donne tout son potentiel. »
Plus complémentaire d’un ensilage d’herbe que de maïs
Enfin l’insertion de luzerne dans la ration mérite aussi d’être réfléchi en amont. « Sa valeur fourragère moindre est vue comme un obstacle à l’intégrer dans des rations à haute densité énergétique, pour des troupeaux laitiers à haut niveau de production, bien que ce soit une excellente source de fibres et que son pouvoir tampon améliore la santé des vaches. L’ensilage d’herbe réalisé tôt, avec de très bonnes valeurs énergétiques et protéiques, est idéalement complémenté par la luzerne, éventuellement associée à du soja aplati, comme le démontre notre dernier essai, l’hiver dernier, sans détériorer la productivité laitière. » Dans ce cas précis, un peu de maïs épis participe à la ration. « L’intérêt est de limiter le recours aux tourteaux protéiques – ici des tourteaux de colza – et cette autonomie est un véritable atout économique. »
Dernier point à ne pas négliger, la fertilisation ! « Cette culture exporte beaucoup de calcium, phosphore et potassium : les apports doivent être fait en conséquent, sous peine de pénaliser le rendement. », conclut le spécialiste.