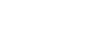Valoriser l’herbe au mieux pour nourrir les bovins tout en maîtrisant les coûts : c’est le défi que relèvent chaque jour les éleveurs. Plusieurs techniques de pâturage existent, avec des bénéfices et contraintes spécifiques. Le bon choix dépend du contexte de chaque exploitation. Le choix repose sur de nombreux critères : surface disponible, météo, moyens humains, objectifs de production. Combiner plusieurs méthodes selon les catégories d'animaux permet de gagner en autonomie et en efficacité.
L’herbe est un atout clé dans l’alimentation des bovins, qu’ils soient laitiers ou allaitants. Bien gérée, elle permet de réduire les charges, d’améliorer la qualité des produits et de préserver les sols. Mais pour en tirer pleinement parti, une gestion raisonnée s’impose.
Pâturage continu : la simplicité, avec ses limites
Le pâturage continu offre une gestion simplifiée, avec un accès permanent des animaux à une parcelle. Cette méthode réduit le temps de travail et favorise le calme des animaux. Cependant, elle présente des risques de surpâturage et de repousse hétérogène de l'herbe, pouvant impacter la productivité des prairies.
Pâturage tournant : une gestion plus fine
Le pâturage tournant consiste à faire changer régulièrement les animaux de parcelle, favorisant la repousse de l'herbe et une meilleure gestion des ressources fourragères. Cette technique améliore le rendement et la qualité de l'herbe, tout en nécessitant une gestion rigoureuse et des infrastructures adaptées.
Pâturage dynamique : l’herbe au plus près de son potentiel
Cette version avancée du pâturage tournant implique des déplacements très fréquents des animaux (quotidiens ou biquotidiens). Elle permet une exploitation optimale de l'herbe, limitant les pertes et améliorant la qualité nutritionnelle. Cependant, elle requiert un suivi attentif, un aménagement spécifique et une technicité élevée.
Pâturage au fil : doser au plus juste
Le pâturage au fil, avec un fil avant (et éventuellement un fil arrière), permet de contrôler strictement la consommation d'herbe. Cette méthode limite le gaspillage, améliore la répartition des déjections animales et favorise une production laitière régulière. Elle implique toutefois des manipulations fréquentes et un investissement en matériel mobile.
Pâturage différé et fauche-pâture : pour l’été ou les animaux à faibles besoins
Le pâturage différé consiste à réserver certaines parcelles pour une exploitation tardive, idéal pour sécuriser l'alimentation estivale. La fauche-pâture combine fauche et pâturage successif, optimisant l'utilisation des prairies. Ces techniques sont adaptées pour des animaux à faibles besoins, comme des génisses en vêlage à 36 mois ou des vaches taries.
Déprimage : stimuler la repousse des prairies
En début de printemps, faire pâturer les jeunes repousses avant fauche permet d’améliorer la qualité du fourrage récolté. Cela nécessite toutefois un bon suivi météo.
Pâturage en sous-bois et sur dérobées : valoriser toutes les surfaces
Le sous-bois offre une solution intéressante, notamment pour les allaitantes, tout en assurant une ombre appréciable. Les cultures dérobées (sorgho, méteil, colza fourrager…) sont également un bon levier pour diversifier l’alimentation.
L’eau, un élément clé à anticiper
L'accès à l'eau est un élément clé du pâturage, et sa gestion varie en fonction des techniques utilisées :
- Pâturage continu : L'eau est généralement disponible en permanence via des points d'abreuvement fixes, ce qui simplifie la gestion.
- Pâturage tournant et dynamique : Nécessite des points d'eau accessibles sur chaque parcelle ou des systèmes mobiles (abreuvoirs déplacés avec les animaux), ce qui demande un suivi et une logistique plus importante.
- Pâturage au fil : Contraignant en matière d'abreuvement, car les animaux avancent progressivement sur la parcelle. Des abreuvoirs mobiles ou un réseau de canalisations sont nécessaires.
- Pâturage différé et fauche-pâture : L'eau doit être anticipée, notamment pour les parcelles éloignées, avec des citernes ou des solutions de pompage.
- Pâturage en sous-bois : L'accès à l'eau peut être un défi, nécessitant parfois des aménagements spécifiques pour assurer une hydratation suffisante.