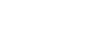Les éleveurs le savent mieux que quiconque : les étés secs, les gels tardifs et les excès d'eau mettent à mal la production fourragère. Face à cette précarité croissante, les cultures dérobées - ces plantes à croissance rapide semées entre deux cultures principales - émergent comme une solution prometteuse. Mais derrière l'enthousiasme des essais, la réalité du terrain impose des choix stratégiques.
Dans les parcelles d'essai des Chambres d'agriculture de Franche-Comté, différentes espèces exotiques ont été testées au poste de dérobée fourragère : moha, sorgho, millet et Teff Grass, souvent associées à du trèfle d'Alexandrie pour améliorer leur valeur alimentaire. Didier Tourrenne, technicien à la Chambre d'agriculture du Doubs détaille : « Le moha est aujourd'hui notre meilleur compromis. Il couvre bien le sol, produit jusqu'à 5 tonnes de matière sèche par hectare, et disparaît avec le gel, ce qui évite les problèmes de repousse. »
« Un panel de solutions, mais pas de miracle »
Chaque espèce possède ses forces et ses faiblesses. Le sorgho, par exemple, affiche une croissance impressionnante - « 50 cm en 50 jours », témoigne un éleveur - mais peut s'avérer toxique à l'état juvénile ou en cas de stress hydrique, et présente des difficultés d’exploitation. Le millet, lui, ne présente pas ce risque, mais sa levée est capricieuse dans les sols argileux. Quant au Teff Grass, ses graines minuscules demandent une implantation méticuleuse, et ses jeunes pousses, mal enracinées, supportent mal le piétinement des animaux.
Adventices, sécheresse : les écueils à anticiper »
Si ces cultures offrent une réponse partielle au déficit fourrager, leur réussite reste soumise à deux défis majeurs : la maîtrise des adventices et les aléas climatiques après le semis. « Une canicule au moment de la levée peut anéantir l'investissement », rappelle Didier Tourrenne. De même, le trèfle d'Alexandrie, pourtant précieux pour capter l'azote, peut disparaître en cas de sécheresse précoce.
« Un surcoût justifié par les bénéfices à long terme »
Implanter un couvert dérobé représente un investissement supplémentaire - entre 90 et 150 €/ha - mais les gains agronomiques dépassent souvent la simple production fourragère. « Ces cultures améliorent la structure du sol, limitent l'érosion et stockent de l'azote pour la culture suivante », souligne le technicien. Pour les éleveurs, la clé réside dans la valorisation par pâturage, qui réduit les coûts de récolte et de conservation.
S'adapter plutôt que subir
Aucune espèce ne constitue une solution universelle. Le sorgho convient aux zones où l'eau n'est pas limitante, le moha aux sols séchants, et le millet aux éleveurs souhaitant éviter tout risque de toxicité. « Tout est une question de pari météorologique », résume Didier Tourrenne. Une certitude, cependant : dans un contexte climatique de plus en plus imprévisible, ces cultures deviennent un outil indispensable pour sécuriser l'autonomie fourragère.