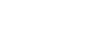Les corvidés, quand ils concentrent leurs attaques sur les graines à peine semées et les jeunes plants, peuvent entraîner des pertes économiques substantielles, obligeant les agriculteurs à procéder à de coûteux resemis. Leviers agronomiques et méthodes combinant prévention, effarouchement et régulation restent de mise face à ce défi printanier récurrent.
La prévention des attaques de corvidés commence par une implantation rigoureuse des cultures. Un semis profond, associé à un sol bien préparé (sans mottes ni résidus), puis correctement rappuyé, limite l’accès des corvidés aux graines. A l’échelle d’un secteur, les semis groupés réduisent la fenêtre d’exposition aux attaques, contrairement aux semis échelonnés qui prolongent la période de vulnérabilité. Mais ils nécessitent une coordination collective… Ces pratiques agronomiques, bien que simples, constituent un premier rempart contre les dégâts.
Le produit Korit 420FS est une solution corvifuge à base de zirame. Cette substance active fait l’objet d’une évaluation en vue du renouvellement de son autorisation au niveau européen dont l’échéance est actuellement fixée au 31 janvier 2027. Cette spécialité commerciale peut donc être utilisée pour protéger les semences des parcelles exposées à un risque d’attaque de corvidés.
Piégeage et effarouchement
Le piégeage à l’aide de cages en métal, dites "pièges à corbeaux", s’avère efficace pour capturer ces oiseaux grégaires. Leur conception en forme de V empêche toute fuite une fois l’oiseau entré. L’appâtage initial avec des graines ou des insectes attire les individus, les prises ultérieures étant facilitées par le comportement grégaire des corvidés. Cette méthode de régulation des populations est toutefois règlementairement encadrée (et animée par la FREDON BFC).
Parallèlement, les effaroucheurs passifs, comme les cerfs-volants imitant des rapaces, créent un environnement hostile. Leur déplacement régulier (tous les 4-5 jours) évite l’accoutumance, un phénomène bien documenté chez ces espèces intelligentes. Les canons à gaz, bien que dissuasifs, requièrent une gestion prudente en raison des nuisances sonores. Leur utilisation est encadrée par le code de la santé publique (articles R. 1336-6 à R. 1336-9), et souvent par des arrêtés locaux limitant les horaires d’activation (interdiction nocturne entre 22h et 7h).
Les plantes-appâts à la rescousse
Les plantes-appâts, comme le blé semé en couvert avec le maïs, détournent l’attention des corvidés tout en offrant des bénéfices agronomiques supplémentaires (lutte contre le taupin). Cette technique, déjà adoptée par certains producteurs, est un exemple de solution multifonctionnelles.
La recherche explore également des pistes prometteuses, telles que les répulsifs bio-sourcés ou les systèmes d’effarouchement automatisés couplés à l’intelligence artificielle pour adapter les stimuli aux comportements aviaires. Des projets collaboratifs, associant instituts techniques (Arvalis, Terres Inovia) et acteurs privés, visent à optimiser ces outils dans le respect des écosystèmes.
Vers une stratégie intégrée
Aucune méthode ne garantit à elle seule une protection totale. La combinaison de techniques culturales, d’effarouchement, et de régulation ciblée maximise l’efficacité tout en réduisant les risques d’accoutumance. Les agriculteurs doivent rester vigilants sur l’évolution réglementaire, notamment les arrêtés préfectoraux, et s’appuyer sur les innovations issues de la recherche. Une approche collective, coordonnée à l’échelle territoriale, pourrait encore renforcer la résilience des cultures face à ces ravageurs.