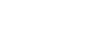Le 9 avril dernier, le lycée (EPLEFPA) de Fontaines accueillait une journée d’échange territoriale dédiée à la gestion des matières organiques dans les sols. Dans un contexte d’aléas climatiques croissants, replacer le sol au cœur des raisonnements agronomiques est à la fois pertinent et impératif. Présentation du projet, visite de l’exploitation agricole du lycée, atelier sur la fertilité des sols étaient au programme, avant de se pencher sur les enjeux liés à l’eau et au sol, et un temps d’échanges visant à faire émerger des synergies locales.
Ce projet Casdar Acec (Accompagnement au changement par l’enseignement et le Conseil agricole), lancé en septembre 2024, entend renforcer les compétences des enseignants, formateurs et conseillers pour accompagner la transition agroécologique. En ce sens, la journée de Fontaines se voulait un temps fort de concertation, d’analyse et de projection collective. En Saône-et-Loire, le lycée veut « monter en compétence les professeurs et les élèves », lançait le directeur, Pierre Botheron. Pour l’autre partenaire départemental, Bourgogne du Sud, il en va de même pour ses techniciens de terrain. Ailleurs, on retrouve d’autres partenaires également intéressés, comme des collectifs en Ille-et-Vilaine, en Haute-Vienne, en Dordogne, en Haute-Saône (AgroCampus Vesoul), dans le Lot, en plus des DDT, Draaf et de la Bergerie nationale. « Il nous faut anticiper et imaginer les exploitations pour tenir compte des défis devant elles, du changement climatique au maintien de la matière organique, déjà abordée dans les formations ». Faisant aussi de la médiation entre public rural et urbain, Fleur Mégnier de la Bergerie nationale de Rambouillet est persuadée que les transitions et adaptations nécessitent de « remettre le sol au cœur des raisonnements agronomiques et économiques », de l’enseignement aux agriculteurs, en passant par leurs conseillers. Le projet vise à faire évoluer les méthodes et les formations pour créer « des outils avec du sens et des méthodes appropriables », tout en renforçant les liens locaux pour « changer d’échelle, de l’exploitation au territoire ». En Saône-et-Loire, le lycée de Fontaines est donc le lieu parfaitement approprié. Cinq autres EPL en France font déjà office ainsi de « tiers lieu » pour des rencontres et échanges. Le directeur adjoint de Fontaines, Samuel Bruley présentait le “collectif” départemental, qui outre la coopérative Bourgogne du Sud, associe deux agriculteurs « mettant à disposition leur exploitation comme support d’expérimentations », à savoir les exploitations de grandes cultures de Régis Têtu (Gaec du Champs Nollot à Fontaines) et de Lionel Borey (SCEA du Lac à Crissey). La première est en conventionnel “classique” tandis que la seconde est en conventionnel mais « zéro labour depuis 1997 », alors qu’elle est située en zone inondable (Saône). Évidemment, l’exploitation du lycée est également de la partie pour rajouter aux essais, « la matière organique issue d’un atelier d’élevage pour voir leurs impacts au niveau du sol », complétait Samuel Bruley. D’ailleurs, outre la visite de l’exploitation par son directeur, le pédologue, Christian Barnéoud a réalisé des profils “3D” sur les trois exploitations, en plus de celle présentée ce jour. Les trois sols ont ainsi été analysés en laboratoire « pour avoir un état des lieux et voir s’il faut ou non revoir les pratiques », en plus d’entretiens « poussés » réalisés par des élèves, pour connaître « le raisonnement agronomique et les choix des itinéraires dans le détail ». Une façon également de faire un premier diagnostic sociologique pour « identifier les compétences et possibilités de changements de pratiques ». Ainsi, les élèves en première année ACD (agronomie et cultures durables) pourront « se mettre dans la peau d’un conseiller et proposer des modifications d’itinéraires techniques » durant les trois prochaines années du projet Casdar.
Plus de variabilité climatique
L’après-midi, un débat prenait place avec Marc Labulle, pour le Département de Saône-et-Loire et les questions de l’eau également pour le Grand Chalon, Antoine Villard, conseiller à la chambre d’agriculture spécialiste du changement climatique en grandes cultures, Stéphane Delaverne pour l’agence de l’eau RMC (Rhône-Méditerranée-Corse) et Lionel Borey, également président de Bourgogne du Sud. Le changement climatique est déjà là, avec une hausse moyenne de « +0,3 °C par décennie » en moyenne à Mâcon jusqu’en 2100, annonçait Antoine Villard, qui souligne surtout « la variabilité » plus marquée au printemps et en été avec plus de jour à +25 °C. Côté pluviométrie, il y aura « plus de pluie », surtout en hiver (+80 mm/an) et au printemps. Ce qui est « contre intuitif » par rapport aux sécheresses estivales « qui seront néanmoins beaucoup plus rudes que 2003 » durant les années caniculaires. Son propos était dès lors de mettre en garde sur le premier enjeu, celui du carbone dans le sol qui permet de limiter la battance, l’érosion et le ruissellement. « Les cultures intermédiaires et les bons choix de cultures peuvent permettre de bons rendements et bons retours de matière organique dans vos sols ». Les questions de semis directs et de limiter le tassement par des « engins » sont comme « la biodiversité des sols », des sources de productivité. À chaque fois, il faudra trouver le « bon compromis » comme entre le travail simplifié du sol et le labour.
Stocker l’eau pour la relâcher quand besoin ?
Si la recharge des nappes ne semble pas poser autant de souci que dans le sud de la France, la Saône-et-Loire va néanmoins devoir « gérer l’eau » avant les sécheresses estivales plus récurrentes. « Avec de gros abats d’eau (hiver et printemps), il faudra trouver des solutions avec les collectivités », à commencer par éviter les excès d’eau, l’érosion des sols et l’inondation des cultures. En charge de ces dossiers, le conseiller département et élu du Grand Chalon, Marc Labulle rappelle que les collectivités « se sont emparées de ces problématiques » depuis 2018 et la compétence Gemapi qui ajoute « la protection des populations ». Prenant l’exemple du Chalonnais, il met autour de la table plusieurs collectivités, syndicats des eaux. « Nous allons vers plus de protection et restauration de zones humides pour améliorer la rétention de l’eau et la relâcher quand besoin ». La Comcom du Grand Chalon lutte contre les pollutions directes ou diffuses. Mais tout ceci n’est possible qu’avec « les propriétaires » car l’entretien « régulier des cours d’eau se situe la plupart du temps sur des terrains privés ». Dès lors, les castors ou curage de cours d’eau peuvent vite devenir autant d’irritants de part et autres. « Il faut énormément d’animations pour que chacun y trouve son compte », noyait-il le poisson. Il se montrait en revanche plus allant sur « l’endiguement » et le suivi des cours d’eau et étiages.
Stéphane Delaverne gère justement des programmes d’interventions et de financements à l’échelle du bassin RMC. Le programme 2025-2030 de cette Agence de l’eau est fondé sur quatre priorités : le bon état de l’eau (directive cadre), l’adaptation au changement climatique, la reconquête de la biodiversité et la solidarité entre territoires (villes/campagne et amont-aval). « Tout débute par la sobriété des usages : travail sur les fuites, goutte-à-goutte, pratiques agricoles… », avec un travail sur la qualité, notamment dans les zones de captage. Mais l’Agence a rajouté une « nouveauté » à ses missions, « le stockage de l’eau dans les sols avec l’aménagement du bassin versant afin de limiter le ruissellement et privilégier les infiltrations dans les nappes ». Ainsi, l’Agence RMC a dégagé des « aides pour les agriculteurs » qui souhaitent faire des « expérimentations, sont en filière bas niveau d’intrants (miscanthus…) ». Les villes ne sont pas oubliées et devront « désimperméabiliser » leurs sols. Les campagnes pourront aménager leurs paysages via l’implantation de haies… « Nous sommes encore en phase d’expérimentations pour passer ensuite à l’opérationnel via des mesures agroenvironnementales par exemple en agriculture, pour des couverts végétaux ou de l’agroforesterie ».
Rotation, légumineuses, génétique…
À Crissey, Lionel Borey exploite 254 ha en « val de Saône » sur des sols « sableux séchants, argilo-limoneux-sableux et d’autres inondables ». Ce risque non négligeable l’a amené à « basculer » en 1997 vers le non-labour pour « développer la résilience de la structure, du carbone, de la faune du sol… ». Pas de solution unique mais une « série de petites mesures qui ont un levier sur l’ensemble du système ». Lionel n’intervient que lorsqu’il estime avoir un « problème de compactions » et préfère jouer sur la « précocité des variétés ou l’aspect variétale génétique (maïs stressless) ». Il gère « ses risques » d’excès d’eau ou de sécheresse avec aussi « plus de diversité dans ses rotations », avec l’introduction de légumineuses (soja, trèfle…) pour obtenir des conditions optimales pour ses blés derrière.
Reste que les risques ne sont pas qu’agronomiques mais plutôt d’ordre économique pour une exploitation. En tant que président de Bourgogne du Sud, Lionel Borey poursuit l’aspect « sécurisation que la coop se doit d’amener avec des solutions sécurisant des revenus ». Cela passe donc par « identifier le matériel végétal adapté à la région » mais aussi par « structurer des filières » (lire article Fop ci-contre). Demain, il en ira de même de la gestion de l’eau, « avec de l’irrigation maîtrisée, en termes de volumétrie et de précision ». La coopérative part de l’économie de filière pour structurer des solutions à long terme comme « valoriser les haies avec des plans de gestion en lien avec des chaufferies pour une économie circulaire » qui plus est. Tout n’est pas parfait du premier coup mais « on apprend chemin faisant avec les collectivités et leurs choix d’équipements », relativise-t-il. Les choix politiques locaux sont finalement aussi structurants que la Pac qui est désormais « plus bénéfique d’un point de vue agronomique ». Mais pour Lionel Borey, comme pour tous les intervenants du jour, le premier facteur d’une bonne gestion des sols agricoles reste que les « agriculteurs aient un maximum de connaissances pratiques pour leur ferme ». Ainsi, la boucle sera bouclée avec ce projet Casdar.
Filière bas carbone : un cercle vertueux pour tous
Alexandre Lachmann, responsable agronomie chez Bourgogne du Sud, introduisait les filières bas carbone. Ces dernières visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Même s’ils ne sont pas les seuls, loin de là, à contribuer, les agriculteurs ont une « part de responsabilité » de l’ordre de 17 % avec la partie méthanisation de l’élevage, les engrais azotés, et la consommation d’énergie. Dès lors, les scientifiques et les conseillers cherchent des leviers qui permettent de réduire ces émissions, y compris à travers de « meilleurs stockages de carbone et d’eau », propice à la productivité au final. Reste que pour l’heure, ces techniques obligent à des « prises de risque », nécessitant des capacités financières (matériels, aménagements, changement de pratiques, de débouchés…) faisant que tous les agriculteurs n’ont pas « envie de prendre ces risques » car ils ne le peuvent tout simplement pas. « On a mis autour de la table plusieurs de nos clients industriels, qui ne sont pas forcément des philanthropes, pour les mettre à contribution sur l’écologie et ainsi améliorer leurs et nos bilans carbones ». Visiblement, Bourgogne du Sud a su être convainquant avec déjà de premiers engagements du côté de la meunerie. « 85 % des émissions de la filière de la meunerie proviennent de la production du blé aux champs, donc ils ont tout intérêt à nous aider pour mettre en valeur une production de farine durable… et vendue plus cher ». D’autres organismes stockeurs et industriels sont dans cette même démarche. De quoi « insuffler une dynamique pour in fine avoir des pratiques plus résilientes aux champs face au changement climatique », tout en améliorant les performances et l’optimisation des intrants. Un cercle « vertueux » pour la biodiversité, les sols, l’eau et l’air avec des « co-bénéfices » pour les agriculteurs, même si cette amélioration des revenus devra être acceptable, atteignable et vivable.