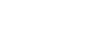Lors de la dernière assemblée générale de la CPASL, la Coopérative avicole avait invité Quentin Mathieu, économiste pour le think tank d’Agridées, à intervenir sur la souveraineté alimentaire, et notamment les enjeux en filière avicole. De quoi se donner des ailes pour le futur.
« Cocorico, en 2024, la volaille est devenue la viande préférée des Français », débutait le jeune économiste d’Agridées, avec 28,5 kg/an/habitant, alors même que les autres viandes sont plutôt en régression ou stagnation. Le poulet est même en forte croissance depuis le début des années 2000. Côté production, les effets se font ressentir avec encore +12 % en 2024… mais qui en réalité n’est qu’un retour au niveau de production de 2005. Un redressement certes « spectaculaire » mais qui cache donc des crises : influenza aviaire et concurrences internationales. « C’est là que le bât blesse ». Les importations n’ont eu de cesse de progresser justement depuis les années 2000, en provenance de Belgique et des Pays-Bas dans un premier temps. La Pologne a rejoint ce duo depuis les années 2010 pour devenir même le premier fournisseur en France. À l’export, la France a été « aux antipodes ». Conséquence, la France a perdu son statut de premier producteur de volailles en Europe « face à des concurrents qui ont mis les bouchées doubles ». Qu’est-ce qui explique que la France n’ait pas su prendre le virage ? Quentin Mathieu, et d’autres experts, estiment que la filière française est restée sur la production de poulets entiers et pour les plats élaborés, alors qu’inversement les concurrents misaient sur les morceaux désossés et découpés, certes moins valorisés au kilo. La filière volaille française n’aurait pas assez investi au niveau industriel comparativement aux Brésiliens par exemple, autre nouveau concurrent.
Pas de poulet entier chez grand-mère
Résultat aujourd’hui, une volaille sur deux est importée en France ! 30 % de la consommation se fait dans des produits élaborés, hors domicile. 53 % mangent de la découpe. « Le poulet entier est passé de mode, même chez la grand-mère », qui ne représente plus que 16 % du total des ventes de poulets. Un changement d’habitude de consommation des ménages qui n’a pas été suffisamment anticipé, la filière étant restée sur son schéma classique de valorisation via les labels (Rouges, Bio…). Les éleveurs doivent « se poser des questions stratégiques », invitait-il à Jalogny où elle était entièrement représentée pour l’AG de la coopérative avicole, avec les abattoirs, couvoirs… La tendance est clairement en train de « glisser » vers une consommation hors domicile, surtout avec les nouvelles générations, notamment dans les fast-foods « qui profitent de la crise des restaurants » en raison des craintes sur le pouvoir d’achat. « Attention, la génération Z n’est pas uniforme et même parfois aux antipodes » des tendances des précédentes générations.
Notre industrie obsolète
La grande question est plutôt la compétitivité « intrinsèque » de la France. Et des différences existent selon les maillons, si on compare les coûts de production des Français face aux pays tiers et intra Europe. Côté élevage, même si les tailles de bâtiments, d’alimentation… font souvent les grands écarts, « le différentiel n’est pas si élevé. 10 % de différence par poulet par rapport à la Pologne. Ce n’est pas négligeable, mais cela montre que les éleveurs français sont performants malgré les contraintes des normes ». Rassurant sur le potentiel facile à libérer donc. Les chiffres sont pourtant impressionnants au départ avec des moyennes d’élevage, « multiplié par trois dans l’Europe et par un facteur dix pour le Brésil ». La France étant à 40.000 poulets et 2.300 m2 de bâtiments.
En revanche, le différentiel inquiétant de compétitivité se joue surtout sur les outils industriels, qui peut aller jusqu’à 30 % de différence avec l’Allemagne. « Il y a la question de la fiscalité, mais surtout, un retard sur la modernisation et la robotisation ».
La crise des volailles standards… françaises
Comment gagner en souveraineté ?, revenait-il à la question de départ. Il évoquait deux grandes pistes, la contractualisation pour re-répartir les marges ou se tourner vers « ce que les consommateurs attendent » à savoir des produits standardisés et d’autres, des produits différenciant. Pour ces derniers produits, la France a le savoir-faire historique… mais n’est plus compétitive sur les produits standards devenus le marché de masse.
Il mentionnait des « leviers » qui peuvent soutenir la filière française, comme la loi ÉGAlim et l’obligation d’acheter des produits de qualité dans les restaurants publics ou encore l’obligation d’afficher l’origine sur les étiquettes. Mais l’on comprenait vite, que les consommateurs, comme les acheteurs publics (et les politiciens), se mentent à eux-mêmes, tout comme les « jeunes générations se déclarent flexitariens, mais oublient de dire qu’ils consomment à l’extérieur plus de viande en fréquence chaque semaine. Ils ne retiennent que la consommation à la maison ».
Mercosur, Ukraine, Trump…
La cause environnementale aura-t-elle un pouvoir supérieur à la nation ? Le bilan des gaz à effet de serre des volailles plaide en sa faveur, mais avec la crise du pouvoir d’achat, pas sûr que les consommateurs aient réellement envie de payer « la note estimée à deux milliards d’€ d’investissements nécessaires pour répondre à ses enjeux », dont 600 millions rien que pour la rénovation des bâtiments et 700 pour « la construction de nouveaux abattoirs ». Avec toujours un contexte géopolitique instable, du côté de l’accord Mercosur, des droits de douane avec l’Ukraine ou ceux décidés par Trump, sur la filière ou sur l’alimentation animale pouvant être taxée en retour par l’Europe. Quentin Mathieu concluait sur une note positive néanmoins : « la filière a montré qu’elle est résiliente et sait se relever. Il faut aborder l’avenir avec sérénité », mais « il y a du pain sur la planche », complétait Patrice Labrosse, le président de la CPASL.